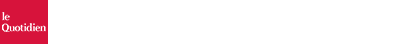L’université d’ottawa a besoin d’un changement de direction
MARIE-CLAUDE LORTIE mclortie@ledroit.com ÉDITORIAL Écrivez-nous Écrivez-nous à redaction@lequotidien.com Pour être publié dans le journal, votre commentaire doit être court et accompagné de votre nom, de votre adresse et de votre numéro de téléphone.
Combien d’erreurs d’aiguillage lui faudra-t-elle encaisser après l’affaire Lieutenant-duval, l’affaire Amir Attaran et maintenant l’affaire de l’ambassadeur chinois Cong Peiwu, pour comprendre qu’il faut peut-être du sang neuf ou du jugement différent à la tête de l’institution ?
À chaque fois, l’enjeu est le même : la liberté d’expression.
Et à chaque fois, la direction ne semble pas capable d’analyser les circonstances et les faits pour faire la part des choses.
Dans le cas de Lieutenant-duval, l’université aurait dû reconnaître la réaction critique des élèves, mais protéger la liberté académique de son professeur et ne pas la suspendre.
Dans le cas d’amir Attaran, la direction de l’université aurait dû réagir bien plus rapidement – il lui a fallu deux semaines ! – pour condamner les propos inacceptables tenus publiquement par son professeur de droit, au sujet du Québec et des francophones.
Et dans le cas de l’ambassadeur de Chine, la direction de l’université aurait dû se poser des questions avant même que la conférence de lundi ait lieu. Est-ce le temps de laisser parler un diplomate sur « La Chine et le monde : développement, commerce et gouvernance au XXIE siècle », alors que ce pays est en train de réprimer massivement et violemment des manifestations populaires de citoyens exaspérés par les mesures sanitaires draconiennes mises en place récemment ? La réponse c’est non et on peut appeler ça aussi un boycott.
Et ça signifie : « laissez vos citoyens s’exprimer et ensuite vous viendrez vous exprimer chez nous ».
Mais non seulement l’université d’ottawa a-t-elle laissé la conférence avoir lieu, elle l’a tenue en respectant les conditions exigées par le conférencier chinois, soit d’interdire les caméras et les enregistrements des journalistes. Le tout en baissant les stores pour qu’on ne voie pas la manifestation pour la défense des droits des Ouïghours, minorité chinoise victime de violation de droits humains, qui se tenait juste à l’extérieur.
Lui dire non, a-t-on alors expliqué, aurait remis la tenue de l’événement en question.
Et bien voilà, parfois il faut dire non et assumer ses choix.
Mercredi matin, après que la classe politique, des professeurs, la Fédération professionnelle des journalistes du Québec et bien d’autres défenseurs de la liberté de presse eussent condamné la décision, le recteur est finalement sorti de son silence, en écrivant ce message sur Twitter.
« Au sujet du cameraman qui n’a pas pu faire son travail lors de la conférence de l’ambassadeur chinois, nous avons pris la mauvaise décision au dernier moment. Nous nous excusons auprès des médias concernés. Nous aurions dû faire mieux pour protéger la liberté de la presse. »
Voilà qui est un peu court pour corriger une telle erreur de posture.
La liberté de presse et la liberté académique sont deux principes sacro-saints de notre société. Ces libertés sont bien sûr encadrées, car il n’y a pas de place pour les discours haineux et la diffamation, entre autres.
Mais elles devraient faire partie des réflexes citoyens les plus ancrés dans notre ADN.
Ceci veut dire que lorsqu’on entend qu’un professeur est critiqué par ses élèves pour ses propos, on part avec l’hypothèse qu’il a le droit de parler. S’il tient des propos racistes ouvertement et volontairement, on réagit. Et on réagit rapidement, comme l’a fait l’université Laval lundi, pour aller chercher des explications, quand une de ses professeurs a parlé publiquement « d’hommes blancs médiocres ».
Avoir la liberté d’expression ancrée dans son ADN, c’est aussi réagir en regardant les reportages faisant état de la répression en Chine et se demander si, dans le contexte, il est à propos de considérer ses émissaires comme des invités acceptables, surtout s’ils imposent des limites à la liberté de presse. C’est une évidence qui ne prend pas 36 heures à considérer.
Si on a déjà peu brillé dans la gestion de crise de liberté d’expression, on devrait avoir le niveau d’alerte au maximum en tout temps.
Et interdire des caméras pour un interlocuteur politique, c’est majeur. En tout temps.
Certains ont dit que le blâme ne doit pas être porté par l’université qui a accepté des conditions inacceptables, mais par celui qui les a imposées et qui a placé l’université dans une situation impossible.
En fait, les deux portent la responsabilité de ce gâchis. La Chine ne devrait pas limiter le travail des journalistes.
Et l’université devrait savoir mieux que quiconque qu’elle ne pouvait que refuser un tel geste.
Certes, l’eau a coulé sous les ponts depuis l’affaire Lieutenant-duval. Il y a eu des pétitions, lettres, livres, études, un rapport, des politiques mises en place pour répondre à certaines des difficultés de l’université, notamment pour faire plus de place aux points de vue francophones.
Mais de toute évidence, le fond du problème qui provoque les réactions mal avisées sur ce qu’est la liberté de pensée et d’expression demeure.
Il est temps qu’un changement de direction permette à l’institution de remettre la circulation inaltérée des idées au coeur de son identité.
Les étudiants, les professeurs, les chercheurs, toute l’équipe de toute l’université, les citoyens d’ottawa et tous ceux qui comptent sur une telle institution, au Canada, pour faire avancer le savoir, méritent mieux.
Il faut en finir avec toute cette série d’erreurs.
ACTUALITÉS
fr-ca
2022-12-03T08:00:00.0000000Z
2022-12-03T08:00:00.0000000Z
https://lequotidien.pressreader.com/article/281865827497397
Groupe Capitales Media